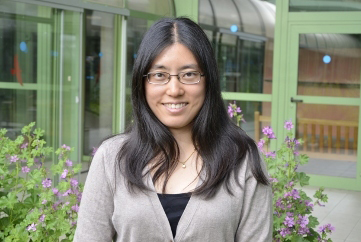Au sein d’une équipe de 14 personnes dirigée par le professeur Jan Roelof van der Meer, Erika Yashiro travaille sur un projet intitulé L'écologie microbienne dans les Alpes. Il a pour objectif d’étudier les effets des changements climatiques sur les communautés microbiennes du sol dans les Alpes et de comprendre la vie microbienne dans le sol en relation avec l'environnement local et avec les plantes. Une recherche qui pourrait aider à mieux saisir ses impacts sur la société, en particulier le tourisme et l’économie.
Durant son enfance, Erika Yashiro a beaucoup voyagé dans le sillage de ses parents. Née à Kobé, elle a vécu au Japon, en Europe et aux Etats-Unis. Une vie nomade qui la conduit, un soir, alors qu’elle est âgée d’une dizaine d’années, sur les rives de l’Atlantique. «Mes parents et moi faisions un tour de France et nous nous sommes arrêtés sur le port de la Rochelle pour nous dégourdir les jambes, se souvient-elle. Il faisait nuit et dans le ciel au-dessus de l’océan, j’ai vu briller la Grande Ourse. Cela a été comme un déclic. Je me suis dis, je serai scientifique.» A l’origine, elle est intéressée par l’astronomie, mais ses parents la découragent en raison du manque de débouchés. Erika Yashiro choisira alors la biologie.
Elle poursuit ses études universitaires aux Etats-Unis, en faculté de biologie. Elle se concentre alors sur la neurobiologie et la biologie comportementale. Passionnée, elle décide de se spécialiser et d’approfondir ses connaissances dans le domaine de la neuroscience cognitive. «Je trouvais que la neurobiologie comportementale était trop terre-à-terre, explique-t-elle. A l’époque, j’avais envie de me spécialiser dans une discipline plus haut de gamme et multidisciplinaire. La neuroscience cognitive mêle la psychologie, la neurobiologie, la linguistique.» En mineure, elle opte pour l’astronomie, qui comprend l’étude de l’astrobiologie et de la climatologie des océans et de l'atmosphère.
Mais les études ne suffisent pas à assouvir sa curiosité naturelle et son inextinguible soif d’apprendre. Durant ses vacances universitaires, elle s’engage donc dans un laboratoire du MIT pour collaborer à des recherches sur la plasticité des neurones. Cependant, l’astrobiologie l’attire comme un aimant, réminiscence de sa toute première vocation d’enfant. En 2002, elle contacte le professeur Stephen Zinder de l’Université Cornell qui travaille sur la microbiologie dans les environnements extrêmes. «Il venait de recevoir une bourse importante pour effectuer des recherches dans les tourbières très acides et avait besoin d’un étudiant pour le seconder, se souvient-elle. Avec Stephen, nous partions sac à dos observer les tourbières et prélever des échantillons. J’aimais ce travail de terrain. Nous observions aussi les castors et les autres phénomènes de l'écosystème et avons ainsi pu noter leur impact sur leur milieu naturel.» Erika Yashiro sourit : «Un jour, je me suis approchée trop près du bord d'une tourbière et je suis tombée dans un lac. Ce n’était pas ma meilleure expérience, mais mon collègue a pu prendre de bonnes photos.»
C’est alors que prend forme sa passion pour le métier de chercheuse. «J’aime faire des choses avec mes mains, j’aime le concret bien plus que rester dans le purement intellectuel, l’abstrait, souligne la jeune femme. La recherche avance, la technologie aussi et cela m’amuse d’y participer. Je vais sur le terrain, je collecte des échantillons. S’il y a des pommiers, je rencontre les fermiers qui m’expliquent comment ils gèrent leurs pommiers, les engrais et les nutriments qu’ils utilisent. J’observe s’il y a une autoroute tout près, ce qui se passe, l’impact de l’environnement et comment tout cela se combine. De retour au laboratoire, j'utilise sur les échantillons les dernières technologies de la microbiologie et de la biologie moléculaire afin de trouver des réponses aux questions scientifiques.»
De 2005 à 2011, elle s’engage auprès de Patricia McManus de l’Université du Wisconsin-Madison, une spécialiste de la phytopathologie qui sera sa directrice de thèse. A cette époque, Erika Yashiro mène de front ses recherches et son doctorat sur la résistance aux antibiotiques dans la phyllosphère, c’est-à-dire la partie des végétaux qui se trouve au-dessus du sol. «Aux Etats-Unis et en Europe, les fermiers utilisent la streptomycine, un antibiotique découvert dans les années 50 et appliqué contre des pathogènes dévastateurs pour les plantes comestibles comme les poivrons, les pommes, les poires, explique Erika Yashiro. Mais, récemment, certains de ces pathogènes ont commencé à montrer de la résistance.» Comme elle n’a pas encore l’intégralité des résultats de cette recherche, aujourd’hui, à côté de ses activités à l’Université de Lausanne, elle continue à y travailler les soirs et le week-end. «Il faut vraiment aimer ce métier pour le faire !», s’exclame-t-elle.
Le chemin qui la mène à Lausanne, où elle travaille désormais comme boursière Marie Curie, fait un crochet par un stage à l’Université de Montpellier dans le cadre d’une bourse d’échange avec l’Université du Wisconsin. Elle y rencontre son ami, qui est européen, et décide de rester en Europe. Par hasard, en surfant sur le site de l’Université de Lausanne, elle tombe sur la page du professeur Jan van der Meer, spécialiste de microbiologie environnementale. N’écoutant que son courage elle l’appelle et lui dit tout de go qu’elle cherche un poste de post-doc. «Il avait ce projet d’étude sur le changement climatique dans les Alpes qui était parfait pour moi, puisqu’il approchait la microbiologie, l’écologie et le terrain.» Mais l’argent manque. Erika Yashiro ne se laisse pas décourager et s’attelle à la rédaction d’un projet de Bourse Marie Curie. «Il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus, relève la jeune femme. Pour l’obtenir, j’y ai passé tous mes week-ends et mes congés durant cinq mois.» Car, dans le dossier de soumission, elle a dû expliquer comment elle pensait ensuite transmettre plus loin ses résultats et quel sera leur impact sur l’avancée de la science en Europe. «C’est une démarche extrêmement exigeante.»
Selon elle, c’est sûr, pour être un bon chercheur, il faut garder les yeux ouverts, et l’esprit aussi. « Il y a des chercheurs qui aiment ce qui est technique, d’autre qui aiment gérer un laboratoire, dit-elle. Moi j’aime les deux et je suis peut-être plus ambitieuse que ce que je devrais.» Elle rit. «Mais le futur chercheur n’est pas obligé de penser que le seul aboutissement d’une carrière, c’est une chaire universitaire. Il y a l’industrie, le gouvernement, les postes plus administratifs, les débouchés sont innombrables.»
Fabienne Bogadi