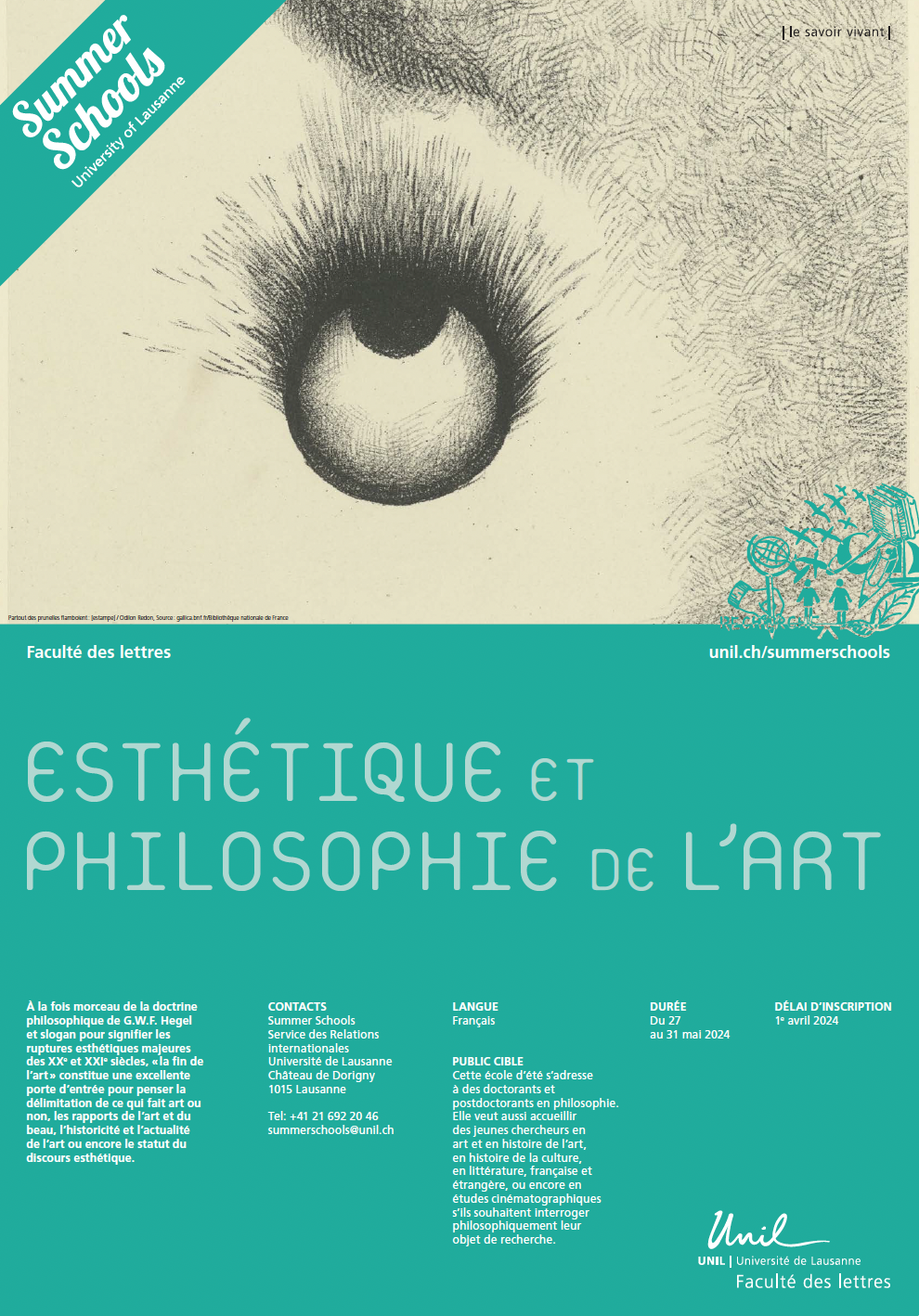Esthétique et philosophie de l’art
À la fois morceau de la doctrine philosophique de G.W.F. Hegel et slogan pour signifier les ruptures esthétiques majeures des XXe et XXIe siècles, « la fin de l’art » constitue une excellente porte d’entrée pour penser la délimitation de ce qui fait art ou non, les rapports de l’art et du beau, l’historicité et l’actualité de l’art ou encore le statut du discours esthétique. La fin de l’art a été l’occasion de réflexions très vives sur les ready made, le pop art, l’art contemporain et ultra contemporain, soupçonné de faire triompher « l’esthétique » et ses atmosphères. Le problème sera ici posé sans cadre chronologique préétabli et sans privilégier tel art sur un autre.
Le suivi des sessions est réservé aux étudiant·es retenu·es pour l'école d'été. Pour toute demande autre, veuillez contacter au préalable les organisatrices.
Esthétique et philosophie de l’art : La fin de l’art
- Description
- Intervenants
- Public cible
- Thématique
- Format du cours
- Objectifs
- Programme
- Prix
- S'inscrire
- Nos partenaires
Carole Maigné, Université de Lausanne
Carole Maigné est professeure ordinaire de philosophie générale et systématique à l’Université de Lausanne. Ses recherches portent sur les philosophies allemande et autrichienne des 19e et 20e siècles. Elle s’intéresse tout particulièrement à la philosophie de la culture (Warburg, Kracauer, Cassirer), à l’esthétique de la photographie et à la philosophie de l’art (formalisme esthétique, école viennoise d’histoire de l’art, Wölfflin, Klein). Elle a publié récemment : The Idea and Practice of Philosophy in Gilbert Simondon (avec Jamil Alioui et Matthieu Amat), Schwabe, 2023 (open access) ; Philosophie de la culture. Textes clés (avec Matthieu Amat, Vrin, 2022), dirigé les dossiers « Austrian Herbartism », Meinong Studien / Studies (2021) et « Philosophie de la photographie », Archives de Philosophie (2022) et co-dirigé (avec Enno Rudolph et Magnus Schlette) le dossier « Logos », Zeitschrift für Kulturphilosophie (2020).
Audrey Rieber, École normale supérieure de Lyon
Audrey Rieber est Maîtresse de Conférences HDR en philosophie à l’ENS de Lyon et membre du laboratoire de recherche IHRIM UMR 5317. Ses recherches portent sur l’esthétique et la philosophie de l’art, notamment sur les questions de forme, d’image, de symbole et d’historicité. Cette réflexion philosophique se nourrit des apports théoriques et méthodologiques d’autres champs qui ont connu un développement original dans le domaine germanophone : histoire de l’art, science de l’art (Kunstwissenschaft), science de l’image (Bildwissenschaft), science de la culture (Kulturwissenschaft), science des médias (Medienwissenschaft). Liste des publications disponible sur : https://ens-lyon.academia.edu/RieberAudrey
Pierre Sauvanet, Université Bordeaux Montaigne
Pierre Sauvanet est professeur d’esthétique et philosophie de l’art à l’Université Bordeaux Montaigne, où il dirige l’unité de recherche ARTES (UR 24141). Ses recherches (qui s’appuient aussi sur une pratique) portent avant tout sur une approche philosophique des phénomènes rythmiques, dans des contextes aussi différents que la pensée grecque, l’histoire de l’esthétique, la survivance des images, les relations entre les arts, le jazz et les musiques improvisées. Il a publié une douzaine d’ouvrages (dont Le Rythme et la Raison, Kimé, 2000, Jazzs, avec Colas Duflo, MF éditions, 2008, L’Insu. Une pensée en suspens, Arléa, 2011, ou Dionysos plasticien. Une lecture nietzschéenne de l’art contemporain, Presses universitaire de Provence, 2023) et une soixantaine d’articles scientifiques.
Bernard Sève, Université de Lille
Bernard Sève est professeur de philosophie émérite de l’Université de Lille. Un aspect important de son travail en philosophie de l’art porte sur la philosophie de la musique : rôle et statut des instruments de musique, musique et temps, processus de citation et de réemploi, son musical et bruit, musique et historicité. Ses travaux en esthétique concernent aussi les rapports entre philosophie et littérature ainsi que la question des usages cognitifs et esthétiques des listes et des tableaux à double entrée. C’est aussi un spécialiste de la pensée de Montaigne. Dans le cadre du thème sur la fin de l’art, c’est son dernier ouvrage : Les matériaux de l’art (Seuil, 2023) qui sera au centre de la discussion sur la définition de l’art et le problème de l’historicité. Liste exhaustive des publications : https://pro.univ-lille.fr/bernard-seve/publications
Hans-Georg Von Arburg, Université de Lausanne
Né en 1966, il a étudié la philologie allemande, la philologie romane et la musicologie à Zurich, Genève et Constance, a obtenu son doctorat en 1996 et son habilitation en 2008 à l'Université de Zurich, puis a été nommé professeur assistant de littérature générale et comparée en 2008 à la même université. Depuis 2009, il est professeur ordinaire de littérature allemande moderne à l'Université de Lausanne. Domaines de recherche principaux : Littérature du 18e au 21e siècle, esthétique générale et littéraire, anthropologie historique, histoire des concepts-métaphorologie-histoire des idées, intermédialité (texte-image-son), littérature et architecture, littérature et physiognomonie, histoire esthétique de l''humeur'. Liste de publications.
Mireille Berton, Université de Lausanne
Mireille Berton est maître d’enseignement et de recherche à la Section d’Histoire et esthétique du cinéma. Ses travaux portent principalement sur les rapports entre cinéma et sciences du psychisme (psychanalyse, psychiatrie, parapsychologie) et mène le projet FNS Cinéma et (neuro)psychiatrie en Suisse : autour des collections Waldau (1920-1970) qui lui offre l’occasion d’orienter sa réflexion vers l’histoire du film utilitaire appliqué aux sciences médicales. En lien avec la thématique, elle a publié Le Corps nerveux des spectateurs. Cinéma et sciences du psychisme autour de 1900 (L’Âge d’Homme, 2015). Outre la direction du projet, elle a comme mission d’investiguer la manière dont les médecins et psychiatres se forgent une nouvelle identité professionnelle à cheval entre arts et sciences. Liste de publications.
Cette école d’été s’adresse à des doctorants et postdoctorants en philosophie. Elle veut aussi accueillir des jeunes chercheurs en art et en histoire de l’art, en histoire de la culture, en littérature, française et étrangère, ou encore en études cinématographiques s’ils souhaitent interroger philosophiquement leur objet de recherche. L’appel à candidature est international.
À la fois morceau de la doctrine philosophique de G.W.F. Hegel et slogan pour signifier les ruptures esthétiques majeures des XXeet XXIe siècles, « la fin de l’art » constitue une excellente porte d’entrée pour penser les fonctions de l’art, les rapports de l’art et du beau, l’historicité et l’actualité de l’art ou encore le statut du discours esthétique. Dans ses Cours d’esthétique, quand Hegel avance sa thèse d’une fin de l’art, il veut dire par là non qu’il n’y aurait plus de production littéraire, plastique ou musicale ni même que les œuvres de son temps n’auraient plus de mérite ou d’excellence, mais que le contenu spirituel de son époque ne s’exprime plus adéquatement dans les beaux-arts et que la modernité a développé un nouveau rapport à l’art qui est de nature réflexive. On aura l’occasion de préciser la signification et la portée exacte de cette position, mais cette thèse étonnante et polémique fournira une matrice de questions et des axes problématiques qu’il sera possible de décliner à des périodes diverses y compris, bien sûr, avant le début du XIXe siècle. La fin de l’art a été l’occasion de réflexions très vives sur les ready made, le pop art (chez Arthur C. Danto dans Après la fin de l’art, 1992) puis sur l’art contemporain ou ultra contemporain lorsque la fin de l’art devient chez Yves Michaud « le triomphe de l’esthétique », c’est-à-dire un pur lieu de discours (L’art à l’état gazeux, 2003). Les problèmes posés par l’évolution de l’art, sa perte, sa décadence et ses rapports avec d’autres formes de la culture, en particulier la politique, la religion et la philosophie pourront avec profit être déclinés à l’âge prémoderne, depuis Platon s’émouvant de la décadence esthétique et morale de l’art de son temps (« classique » pour nous !) comparé au hiératisme égyptien. Si Hegel raisonne dans le cadre des beaux-arts, il sera pourtant aussi indispensable d’ouvrir la réflexion à d’autres médiums. L’invention de la photographie n’est-elle contemporaine de la publication posthume des Cours d’esthétique ? La question de la destination de l’art devra donc être également pensée à l’ère de la reproductibilité technique, pour parler comme Walter Benjamin, ou dans la condition média-technique du numérique, pour parler comme Friedrich Kittler. L’ouverture à l’artisanat, à l’art « brut », à l’ art « premier », à l’art « préhistorique » est aussi souhaitée ainsi que des questionnements sur le musée et la muséographie. Au moment où Hegel dispense ses cours à l’Université de Berlin, l’Altes Museum de Berlin est achevé (en 1828) et l’institution muséale se consolide en Europe. C’est donc aussi une réflexion sur le musée qui est nécessaire, qu’il soit imaginaire comme chez Malraux ou institutionnel. Enfin, on sera sensible aux approches philosophiques nourries des savoirs, méthodes et questions d’autres disciplines où le diagnostic de la fin de l’art a aussi résonné et déplacé les lignes ; dans la théorie littéraire où, alors qu’il discute les thèses de Hegel, Maurice Blanchot raisonne en termes d’avenir de l’art (L’espace littéraire,1955) ou encore en histoire de l’art quand Hans Belting s’interroge sur la fin éventuelle de sa discipline (L’histoire de l’art est-elle finie ?, 1983).
L’école d’été en esthétique et philosophie de l’art offrira aux participants la possibilité de travailler de manière intensive au thème annuel à partir d’une méthodologie plurielle car délibérément internationale et interdisciplinaire, afin de mesurer et déplacer les usages. Chacun s’impliquera de manière active, cette école d’été récuse une situation d’apprentissage passive, pariant sur de jeunes chercheurs se constituant des réseaux.
Chaque participant est invité à présenter son travail de recherche en cours (travail de thèse, article en cours de rédaction, traduction en cours de réalisation) sous l’angle de « la fin de l’art ». Outre une conférence inaugurale des organisatrices, le travail commun sera enrichi de deux conférences plénières (conférences longues suivies de discussions) avec Pierre Sauvanet (Université Bordeaux Montaigne / ARTES (UR 24141)) autour de la musique et Bernard Sève (professeur émérite, Université de Lille) autour de son dernier ouvrage Les Matériaux de l’art. Une demi-journée sera consacrée à un atelier de traduction prenant le français, l’allemand et l’anglais pour langues de travail, animée par Hans-Georg von Arburg (Université de Lausanne, section d’allemand). Une séance de cinéma interrogeant le thème sera proposée, grâce à Mireille Berton (Université de Lausanne, section cinéma). Des visites permettront de développer la réflexion dans des institutions muséales lausannoises, devant les œuvres et avec des spécialistes : musée de l’Art Brut ; musée Élysée Photo (expositions autour de Man Ray, Christian Marclay et Aurélie Petrel, une rencontre avec cette dernière est prévue) et le Musée des beaux-arts (site Plateforme 10).
La langue de travail principale est le français. Des exposés peuvent être tenus en anglais à condition que les étudiants aient une très bonne compréhension passive du français.
L’école d’été en esthétique et philosophie de l’art se fixe comme but d’offrir aux étudiants les possibilités suivantes :
- travailler de manière intensive au thème de l’école
- bénéficier d’une méthodologie plurielle portée par les habitudes d’enseignement et de recherche différentes selon les enseignant·es-chercheur·euses qui interviendront
- travailler de manière interdisciplinaire en développant des outils pour rendre cette démarche féconde, la pratique de l’interdisciplinarité devant en effet être apprise
- commencer à constituer eux-mêmes leur propre réseau, entre étudiants de la même génération.
- s’ouvrir à la recherche au niveau international
- briser la situation passive d’acquisition du savoir pour apprendre par la recherche
Vous trouvez ci-dessous le programme provisoire :
Le suivi des sessions est réservé aux étudiant·es retenu·es pour l'école d'été. Pour toute demande autre, veuillez contacter au préalable les organisatrices.
Le prix comprend :
- Les frais d’enseignement
- Les repas de midi
- Les pauses-café
- Un apéro d’accueil
- Activités culturelles
L’hébergement peut être pris en charge, sous réserve de places disponibles. Veuillez nous indiquer si vous avez besoin d’un hébergement lors du dépôt de votre candidature, dans la section « Remarques ».
Les étudiants intéressés sont priés d’envoyer en un seul document pdf :
- un curriculum vitae incluant le cas échéant la liste des publications. Indiquer le titre de la thèse et le nom du directeur de thèse.
- une lettre de motivation (une page) expliquant la manière dont la participation à l’école d’été s’insère dans le parcours de recherche
- Un résumé de l’exposé qui sera proposé pendant l’école d’été et qui portera sur les travaux en cours. Une attention particulière sera portée à l’articulation au thème annuel. Les candidats sont aussi invités à souligner les aspects méthodologiques qu’ils souhaiteraient discuter. Ils peuvent présenter leur thèse ou une partie de thèse, un article en cours de rédaction voire une traduction en cours d’un texte traitant de manière explicite de la fin de l’art.
Lorsque votre dossier est complet, merci de sélectionner l’option “soumis” qui se trouve dans la colonne “Statut dossier”. Votre candidature sera alors examinée par les responsables académiques de l’école d’été. Les candidat·es sélectionné·es seront invité·es à payer les frais d’inscription à la suite de l’approbation de leur candidature. L’inscription sera confirmée après réception du paiement.
Le délai de candidature est fixé au 17 avril 2024.
Cette école d’été est organisée par la Section de philosophie de l'UNIL, avec le soutien du Service des Relations internationales, ainsi que l’IHRIM UMR 5317 et l'ENS de Lyon.